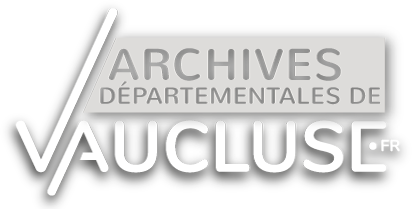La nécessaire combinaison des évacuations des camps et des retours

© Libération
Nous allons à Pitchipoi, ce mot yiddish qui désigne une destination inconnue et sonne doux aux oreilles des enfants qui le répétaient pour parler des trains qui s’en allaient.
Marceline Loridan-Ivens, Et tu n’es pas revenu, 2015
23 juillet 1944, un premier camp est découvert par l’Armée rouge en Pologne. D’abord camp de concentration puis centre d’extermination, Majdanek, a été vidé de ses prisonniers issus pour la plupart du ghetto juif de Varsovie. Le 27 janvier 1945, Auschwitz est libéré ; le 30 avril, c'est au tour de Ravensbrück, sinistre camp de femmes où furent déportées Yvonne de Komornicka et Madeleine Croset, d'être délivré. Les armées russes et américaines progressent en tenaille. Avant de prendre la fuite, les officiers et les gardes SS procèdent systématiquement à l’effacement des preuves de leur action génocidaire en détruisant à la hâte les équipements et les traces administratives de leurs crimes. Ils transfèrent les prisonniers encore valides vers d’autres camps en se déplaçant au gré des opérations militaires des alliés. Beaucoup de déportés périssent de faim, de froid et d’épuisement au cours de ces déplacements interminables baptisés par les rescapés “marche de la mort”.
En France, le Gouvernement provisoire de la République française doit faire face à un enjeu de taille : le rapatriement des deux millions de victimes de guerre restées en Allemagne. En octobre 1944, le général de Gaulle confie le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, au résistant Henri Frenay. Le ministre qui envisage des retours par vagues successives doit modifier ses plans à cause des évacuations régulières des camps par les alliés. Et la mission s’avère très complexe en raison de l'hétérogénéité des statuts des victimes et de leur faiblesse physique extrême.
Si le terme de réfugié s’applique sans équivoque au cas des Alsaciens-Lorrains, celui de déporté désigne tout à la fois les prisonniers de guerre, les hommes partis au titre du Service du travail obligatoire (S.T.O.), les déportés politiques et ceux victimes de persécutions. L’opinion publique fait difficilement la différence. Il faut attendre la libération totale des camps et la matérialité jusque-là insoupçonnée de l’horreur concentrationnaire pour caractériser les victimes. Le mot juif ou même la notion d’appartenance à la communauté israélite dans les motifs de déportation fait tardivement son apparition dans les documents officiels et la presse qui évoquent essentiellement les déportés politiques. Pour l’administration, qui raisonne alors selon des impératifs logistiques, le faible nombre de Juifs déportés encore vivants ne peut rivaliser quantitativement avec le flot de prisonniers de guerre, de S.T.O., de déportés politiques et de réfugiés à rapatrier.

© JDD
Nous y avons rejoint tous les autres détenus des camps d’Auschwitz, environ quarante mille personnes, et avons entamé cette mémorable longue marche de la mort, véritable cauchemar des survivants, par un froid de quelque trente degrés en dessous de zéro.
Simone Veil, Une vie, 2007